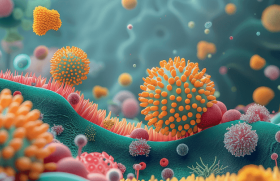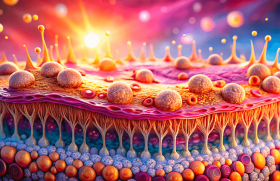Publié le 20 fév 2025Lecture 3 min
Prise en charge de l’eczéma chronique des mains en France
Catherine FABER, d’après la communication d’A. Soria

L’enquête nationale CHEMIN (Chronic Hand EczeMa INvestigation) a permis d’identifier les pratiques actuelles françaises dans le diagnostic, l’évaluation de la sévérité et le traitement de l’eczéma chronique des mains.
Cette enquête* repose sur un questionnaire en ligne rédigé par six experts de l’eczéma chronique des mains (ECM). Elle s’est déroulée en deux tours : du 15 juillet au 15 octobre 2023 (135 répondants), puis du 27 novembre 2023 au 17 janvier 2024 (120 répondants). Deux tiers des médecins répondants étaient des dermatologues (52 % des allergologues et 15 % des dermato-allergologues), 30 % des médecins du travail et 4 % des allergologues. Ils prenaient en charge en moyenne six patients atteints d’ECM par mois et avaient le plus souvent un mode d’exercice exclusivement hospitalier (30 %) ; 20 % exerçaient à la fois en milieu hospitalier et libéral, 26 % dans des services de prévention et de santé au travail et 1 % en privé. L’enquête des pratiques a été couplée à la méthode Delphi utilisée pour établir un consensus professionnel.
Un consensus s’est dégagé sur deux points : l’orientation diagnostique en fonction de l’aspect clinique et les critères cliniques de sévérité de l’ECM. Les éléments sémiologiques évocateurs d’un ECM sont le prurit, les vésicules, les fissures, les saignements et la lichénification. L’atteinte de la pul pe des doigts est reconnue comme évocatrice d’une étiologie allergique alors celle du dos des mains oriente vers une origine irritative. Les critères cliniques permettant d’évaluer la sévérité de l’ECM sont l’étendue de l’atteinte, les fissures et les saignements, la lichénification, la douleur et les œdèmes. Pour 36 % des répondants, la sévérité de l’ECM peut aussi être évaluée sur la base de critères non cliniques comme les arrêts de travail ou la nécessité d’un suivi médical régulier. Plus de la moitié des médecins (57 %) n’utilisent pas d’échelle, et aucune échelle n’a obtenu de consensus pour évaluer la sévérité de l’ECM. L’outil le plus utilisé (41 % des médecins) est le DLQI (Dermatology Life Quality Index). Au final, la méthodologie n’a pu aboutir à une standardisation de l’évaluation de la sévérité.
Les questions sur les indications du bilan allergologique et sur la stratégie thérapeutique n’ont pas été soumises à la méthode Delphi pour l’évaluation d’un consensus. Le bilan allergologique est quasi systématique lorsque les symptômes apparaissent en milieu professionnel et s’améliorent lors des périodes de congés. Dans d’autres situations, il est souvent, mais pas systématiquement, réalisé : chez les patients de profession en contact avec des substances sensibilisantes, irritantes ou allergisantes ; quand l’interrogatoire retrouve un facteur ; en cas d’échec ou de résistance au traitement local ou d’exacerbation des lésions jusque-là bien contrôlées par un traitement local ; en présence de poussées fréquentes. Le bilan repose essentiellement sur les patch-tests et les tests ouverts d’application répétée (ROAT : Repeated Open Application Test). Les prick-tests et le dosage des IgE totales ou spécifiques ne sont utilisés que dans de rares cas.
Les dermocorticoïdes forts à très forts, en plusieurs cures prolongées, constituent le traitement de première intention de l’ECM (93 à 99 % des médecins). Ils sont prescrits en association plus ou moins fréquente avec d’autres mesures comme l’éviction des contacts et des irritants (51 à 93 %), l’éducation thérapeutique du patient (55 à 71 %), les émollients (74 à 86 %), le wet wrapping (20 à 33 %) et les inhibiteurs de la calcineurine (31 à 34 %) lesquels, rappelons-le, ont une AMM uniquement chez les patients atteints de dermatite atopique (DA). Concer nant les traitements de deuxième intention, les pratiques sont très hétérogènes, avec la prescription principalement d’alitrétinoïne, qui a une AMM dans l’ECM sévère, et, en cas d’échec, d’autres médicaments, soit hors AMM (méthotrexate), soit ayant une AMM seulement dans la DA (ciclosporine, dupilumab, tralokinumab).
En conclusion, l’enquête CHEMIN témoigne de la complexité de la prise en charge de l’ECM. Elle démontre le besoin de nouvelles options thérapeutiques en deuxième intention et souligne la nécessité de réaliser des études de comparaison des traitements méthodologiquement solides.
* Enquête réalisée avec le soutien logistique de LEO Pharma.
D’après la communication d’A. Soria, Paris, GERDA 2024.
Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.
pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.
Si vous êtes déjà inscrit,
connectez vous :
Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,
inscrivez-vous gratuitement :